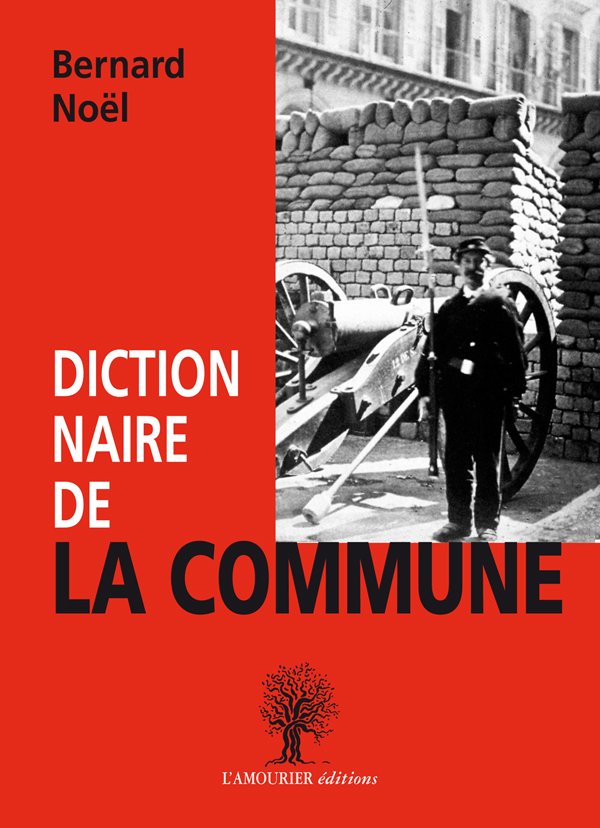LA VIE QUOTIDIENNE SOUS LA COMMUNE
À propos du Dictionnaire de la Commune
Entretien avec Bernard Noël conduit par Harold Portnoy diffusé sur France Culture le 26/06/1971

Hier, il y a 100 ans, c’était la Commune. Que sait-on de la vie quotidienne des gens durant cette période d’effervescence et de tempête? Que peut-on dire des prises de conscience occasionnées par ce moment en rupture de continuité? Bernard Noël est l’auteur d’un Dictionnaire de la Commune qui vient de paraître aux éditions Fernand Hazan. Je lui ai tout d’abord demandé pourquoi il a traité ce sujet.
Ce qui m’a donné envie de parler de la vie quotidienne d’il y a 100 ans c’est celle que j’ai connue en mai 1968. Indépendamment de tout ce qui se passait par ailleurs, ce que j’ai trouvé de très touchant en mai 68 c’est que, tout à coup, il n’y avait plus de ghetto entre les gens: on pouvait parler avec n’importe qui dans la rue, cela n’avait rien d’équivoque. Brusquement, il n’y avait plus d’intellectuels, d’ouvriers, ou de paysans –ce sont des catégories grossières… Même les gens qui vivaient à l’intérieur d’un même immeuble et qui ne se parlaient sans doute jamais, tout à coup discutaient ou échangeaient des choses. Je me souviens d’un soir, boulevard Saint-Germain, où tous les gens s’arrêtaient et parlaient entre eux sans problème, même s’ils avaient des opinions extrêmement contraires, c’est-à-dire que des gaullistes discutaient calmement avec ce qu’on appelle maintenant des «gauchistes». Ce qui s’est passé en mai 68 m’a beaucoup touché sur ce plan-là et m’a donné envie de savoir ce qui s’était passé avant, à l’origine des mouvements socialistes. L’autre grand moment c’était la Commune, d’où ce livre.
Comment peut-on ici, avec la parole et dans un laps de temps d’une demi-heure, comment peut-on essayer d’approcher cette vie quotidienne? Que faisons-nous ensemble? Nous descendons dans la rue? Voulez-vous que nous soyons dans un immeuble?
Je crois qu’on peut commencer dans la rue, tout simplement. Je me demande si la révolution –avec ou sans grand R– ce n’est pas quand l’idéologie devient un phénomène quotidien: tout à coup, il n’y a plus d’un côté, la politique et de l’autre, la vie quotidienne, mais la vie quotidienne devient politique. Il n’y a plus de grands problèmes réservés à des messieurs spécialistes des Affaires étrangères, de la Sécurité sociale, du logement ou de je ne sais quoi: tout le monde s’y intéresse. En 1871, je crois que ce que voulaient les Communards c’était, justement, mettre en évidence le fait que les problèmes généraux intéressent tout le monde, que tout le monde en est responsable, pas plus… Leur grande idée a été appelée depuis la «démocratie directe». Pour eux, les fonctionnaires, par exemple, ne devaient pas être nommés par le Gouvernement: ils devaient être élus par les intéressés, donc responsables et révocables si les intéressés n’étaient pas d’accord. On peut croire que cela aurait introduit une gigantesque pagaille. C’est un peu ce qu’il s’est passé mais il faut bien apprendre à faire les choses… On peut se dire que les affaires de gouvernement ne s’improvisent pas mais finalement, je crois qu’elles s’improvisent. Rosa Luxembourg disait qu’un peuple apprenait beaucoup plus en deux mois de révolution qu’en vingt ans d’études. Je crois en effet qu’en vingt ans d’études, on n’apprend rien et qu’en deux mois d’expérience, on apprend tout, en tout cas, pas mal de choses.
Ce qui me frappe dans ce que vous venez de dire c’est ce rapport entre politique et vie quotidienne parce qu’il rejette la vie quotidienne vers l’aliénation sauf à des moments «privilégiés» –je ne sais pas si c’est le mot qu’il faut employer–, des moments «aigus», disons, comme 1871. Mais qu’est-ce que ça veut dire? À part des moments où la vie s’arque, où les cours prennent des dimensions violentes, la vie quotidienne c’est une façon de ne pas respirer?
La vie quotidienne c’est l’oubli: on s’oublie dans les petits problèmes quotidiens. C’est peut-être un problème d’éducation. On pourrait se demander quel doit être le rôle de l’éducation dans la vie quotidienne. Elle est en général une façon de plier les gens à un certain modèle. Tout fonctionne bien à partir du moment où personne ne se pose de problèmes, c’est évident! Après avoir fait ce travail sur la Commune, il me semble que la véritable éducation serait d’enseigner aux gens à se rebeller continuellement. La véritable école serait la rébellion permanente, ce qui ne veut pas dire que ce serait la pagaille permanente, comme on a tendance à le croire: c’est simplement la responsabilité permanente. Quand on dit non, on sait pourquoi et à quoi on dit non, alors que la vie qu’on nous enseigne est un perpétuel oui, et un oui inconscient à tout.
Inconscient, dans le sens «ne pas voir» et pas dans le sens «travaillé de l’intérieur»?
Oui, bien sûr. À propos de ce que vous disiez tout à l’heure sur la vie quotidienne aliénée, je crains qu’en dehors de ces explosions, la vie quotidienne ne soit qu’une aliénation permanente. Ce qui est bizarre c’est qu’en mai 68 –je crois qu’en mars 1871 c’était pareil– pendant quelques jours, peut-être une semaine, tout était possible. Au moment où la crise éclate, toutes les réformes sont possibles parce que les gens, dans cette atmosphère de liberté inconnue, sont prêts à sacrifier beaucoup de leurs privilèges, de leur confort. Puis tout à coup, ils se reprennent –bien avant d’ailleurs qu’on s’aperçoive qu’ils se sont repris– et tout tourne à l’envers: la Commune de 71 finit par le plus grand massacre de l’Histoire de France et mai 68 aurait pu finir de même. À un cheveu près, cela aurait pu être un massacre…
C’est curieux, comme terme, se «reprendre»: se prendre à nouveau? Se pendre? (rires)
Généralement, quand on se reprend, ce devrait être un verbe extrêmement péjoratif…
Ce n’est pas un mouvement vers la vie, vers la découverte. C’est un mouvement où je compte mes billes.
C’est un mouvement où je compte mes billes et je me retire du courant!
Est-ce qu’on pourrait entrer dans le détail photographique –avec les mots– de ces années 1870 et 1871?
On pourrait parler, par exemple, de la vie des femmes pendant la Commune. Il semble que la partie de la population qui a été le plus sensible à ce qui s’est passé soit probablement les femmes, peut-être parce qu’elles étaient plus aliénées que les hommes, ce qui n’est pas sûr d’ailleurs. Dans tous les mouvements républicains révolutionnaires de la fin de l’Empire, les femmes jouaient un certain rôle, qu’il est difficile d’apprécier parce qu’il y avait tout de même toujours, de la part des hommes, ce sentiment de supériorité contre lequel les femmes se déchaînent maintenant. Or en 1871, il y a eu un certain nombre d’hommes qui ont eu la conscience de cette «camaraderie» –à défaut d’autre terme–, d’une tendresse camarade, disons, qui était déjà une forme d’égalité. Un homme comme Varlin a toujours lutté pour que les femmes aient les mêmes droits, les mêmes responsabilités que les hommes.
Dans mon jargon un peu psychologisant, je dirais que le regard porté sur la femme n’était pas un regard porté vers un objet mais vers un autre sujet, quelqu’un de différent mais un sujet.
Victor Hugo, parlant des femmes, en a dit quelque chose qui me semble assez juste: «Il est douloureux de le dire: dans la civilisation actuelle, il y a une esclave. La loi a des euphémismes; ce que j’appelle une esclave, elle l’appelle une mineure, cette mineure selon la loi, cette esclave selon la réalité, c’est la femme. L’homme a chargé inégalement les deux plateaux du code, dont l’équilibre importe à la conscience humaine; l’homme a fait verser tous les droits de son côté et tous les devoirs du côté de la femme. De là un trouble profond. De là la servitude de la femme. Dans notre législation telle qu’elle est, la femme ne possède pas, elle n’est pas en justice, elle ne vote pas, elle ne compte pas, elle n’est pas. Il y a des citoyens, il n’y a pas de citoyennes. C’est là un état violent: il faut qu’il cesse 1». Hugo balance cela comme une antithèse mais je crois que cela reflète assez bien la réalité du temps.
1) Lettre à Léon Richer, rédacteur en chef du journal L’Avenir des femmes, 8 juin 1872.
Au fond, c’est intéressant ce que vous disiez: c’est parce que plus aliénée que la femme a peut-être réagi plus violemment.
Il y a une chose que j’ignorais avant de faire ce travail c’est que sous le Second Empire, par réaction à la fois contre cette société extrêmement contraignante et extrêmement aliénante où seuls comptaient la spéculation et l’argent, plus du tiers des ménages ouvriers n’étaient pas mariés et vivaient en concubinage, ce qui ne pouvait qu’accentuer la responsabilité mutuelle, je crois.
Mais pourquoi créer un foyer libre?
D’abord il y a une raison qui peut paraître de nos jours un peu anecdotique: c’était beaucoup par anticléricalisme. L’Église, sous le Second Empire, avait partie liée avec le pouvoir puisqu’il n’y avait pas séparation entre l’Église et l’État. L’une des façons de réagir contre l’Église était de refuser ses sacrements donc le mariage. Et puis il y avait aussi une raison économique: la plupart des ménages ouvriers étaient si pauvres qu’ils préféraient rester dans l’illégalité parce que c’était sans doute moins cher. Fonder un ménage obligeait à des cérémonies extérieures.
Il n’y avait pas de Sécurité sociale.
Il n’y avait pas de Sécurité sociale, pas d’allocations familiales et si l’on se mariait, il était encore de coutume de faire les choses bien, c’est-à-dire de faire un repas, etc. Alors que si l’on «se mettait ensemble», comme on dit, pas de problèmes!
Qu’est-ce que vous voulez dire lorsque vous signifiez que la femme a joué un grand rôle pendant la Commune?
Louise Michel en est l’exemple type. La femme a joué un grand rôle en ce sens qu’elle a assumé d’abord un rôle d’organisation en créant dans les quartiers des Comités de femmes. Cela a commencé, en fait, pendant le Siège de Paris: les mois de Siège ont été aussi une situation exceptionnelle en ce sens que les gens n’avaient rien d’autre à faire –et Dieu sait qu’après les Versaillais le leur ont reproché!– que de penser à ce qui se passait. Ce qu’il se passait c’était qu’il n’y avait plus rien à manger, c’était l’hiver, etc. Beaucoup de femmes comme Louise Michel, mais aussi des hommes comme Varlin, ont créé dans leurs quartiers, dans leurs mairies, des restaurants communautaires qu’ils appelaient des «fourneaux», dont le but était de fournir à chacun un minimum de nourriture, de chauffage ou d’habillement. Ces associations fondées pendant le Siège ont été aussi des foyers de résistance contre la capitulation. Ce qui est paradoxal, en remontant un peu plus haut, c’est que ce Gouvernement portant le titre de Défense nationale qui tenait Paris pendant le Siège, n’avait en réalité qu’un souci, c’était de capituler le plus vite possible pour limiter les dégâts! Au fur et à mesure que le Siège durait, le Gouvernement se rendait compte que d’une part, le peuple prenait conscience du tort qu’on lui faisait et de l’autre, son patriotisme s’exacerbait donc il voulait la résistance à outrance. Ce n’étaient pas les gouvernements et les généraux dont c’est le métier qui voulaient résister aux Allemands, c’était le peuple. Et ce peuple s’organisait politiquement, pas seulement sur ses idées mais à travers des associations pratiques comme les cantines et les associations de secours qui se fondaient. Ce qui marque peut-être la Commune c’est que la politique est née d’associations de secours qui n’avaient été créées à l’origine que dans le but purement pratique de venir en aide aux gens. C’est à travers ces cadres-là que la politique est née, et non l’inverse. La Commune suit le Siège d’assez près puisqu’il se passe un mois et demi entre les deux et ces cadres subsistaient encore. La vie n’était pas redevenue normale à Paris donc la politique s’insère dans des cadres qui n’avaient trait qu’à la vie quotidienne.
La communication passait un peu par des rencontres de groupes?
Oui. Dans le prolétariat parisien, les femmes étaient la partie la plus exploitée. Une institutrice gagnait entre cinq et six cents francs par an. Une ouvrière gagnait entre cinquante centimes et deux francs cinquante par journée de travail, ce qui ne veut pas dire qu’elle gagnait dans le mois trente fois deux francs cinquante, puisqu’il y avait des jours chômés. Dans la plupart des corps de métiers, il y avait un chômage saisonnier qui pouvait toucher n’importe qui. Une chambre d’ouvrier coûtait à l’époque environ cent francs donc une femme qui gagnait cinq cents francs par an grosso modo disposait de quatre cents francs pour vivre, s’habiller, etc. C’était pratiquement la misère. La condition du prolétariat parisien pendant toute la fin du Second Empire –et probablement pendant tout le Second Empire– était toujours proche de la misère, avec la crainte de perdre l’emploi. La grande réclamation du prolétariat depuis 1830 était tout simplement le droit au travail parce que personne n’était assuré d’un minimum d’emploi continu, ce qu’on retrouve dans Zola, par exemple: tout le monde veut travailler mais tout le monde n’a pas de travail.
Vous insistez beaucoup sur la femme. Comment a-t-elle joué un rôle par rapport à l’action elle-même?
Louise Michel –dont je vous parlais tout à l’heure– a joué un rôle le 18 mars dans l’insurrection parisienne, insurrection qui n’est pas du tout spontanée, contrairement à ce qu’on peut croire, qui n’a pas été préparée, je veux dire que les choses allaient probablement vers une insurrection mais qu’elle s’est produite plus tôt que prévu parce que Monsieur Thiers l’a faite éclater pour pouvoir la mater en trois jours: il croyait que les révolutions parisiennes duraient trois jours. Il avait vu cela en 1830 et en 1848; il pensait que ce serait pareil et que trois jours après, il arriverait à Versailles en vainqueur. Il savait que pour exciter les Parisiens, il fallait leur reprendre leurs armes. Il a essayé et les Parisiens se sont fâchés donc ils sont descendus dans la rue. Finalement on s’est aperçu qu’il n’y avait plus de gouvernement. Tout le monde a fichu le camp. Thiers a donné d’ailleurs l’ordre de partir et tout le monde a filé à Versailles…
Je crois que les femmes ont joué un grand rôle dans cette journée en appelant les hommes à descendre dans la rue. Ensuite, une femme comme Louise Michel a été plus souvent aux tranchées, habillée en Garde national, et elle s’est battue pendant les deux mois et demi qu’a duré la Commune. Les femmes ont joué un plus grand rôle comme infirmières, cantinières, etc. mais comme elles étaient proches des problèmes pratiques –et la vie pendant la Commune posant surtout des problèmes pratiques– elles se trouvaient au premier rang.
Que peut-on éclairer encore comme aspect ?
Au départ, j’aurais voulu surtout parler de la vie quotidienne. Elle nous intéresse de plus en plus mais à l’époque, c’était la chose qu’on passait sous silence, de telle sorte que les journaux d’alors parlent éventuellement des cours de la Bourse mais rarement des cours des Halles. On apprend de temps en temps qu’il y a une distribution de viande à un tarif peu élevé. La Commune s’était préoccupée d’ouvrir trois ou quatre boucheries municipales à Montmartre, où l’on vendait la viande à un prix taxé. Il y avait des distributions de lait. Il est difficile d’avoir des renseignements très précis, sauf quand la vie quotidienne touche plus directement la politique, je veux dire quand on peut la codifier. Par exemple, dans le domaine de l’éducation, la Commune prend des arrêtés pour rendre l’enseignement laïque, obligatoire et gratuit, ce qui est une révolution. La Commune est contre la prostitution, en y voyant une sorte d’aliénation. Cela devient tout à coup un péché social sans qu’on sache très bien pourquoi: on change les termes. On prend des arrêtés pour la supprimer mais pas pour guérir le mal.
C’est souvent comme ça… (rires)
Dans cette vie quotidienne de la Commune, il y a un point qu’Henri Lefebvre a souligné, c’est la fête. Très certainement, les premiers jours de la Commune ont été ressentis comme une grande fête populaire. Lefebvre l’analyse très bien comme une espèce de grande explosion théâtrale dans laquelle la cité joue –et où se joue son destin–, ce qu’on a pu ressentir en mai 68 et qui n’est sans doute pas le fond du problème.
La fête, le désir de fête?
Oui. Laquelle fête continue ensuite par des choses comme les funérailles des premiers Gardes nationaux tués au combat qui donnent lieu, par exemple, à de gigantesques fêtes funéraires à travers Paris. Quand les francs-maçons prennent parti pour la Commune, ils défilent avec leurs bannières et leurs insignes à travers Paris pour aller planter des bannières sur les remparts, disant: «Si une balle versaillaise touche l’une de nos bannières, nous prenons le parti de la Commune». Et puis il y a très souvent des concerts dans les rues au bénéfice des veuves et des orphelins. Il y a des grands concerts aux Tuileries. Tout cela créait dans Paris une espèce d’élan communautaire, en tout cas d’émotion et de sentiment communautaire.
C’est un moment très cathartique d’émotion et de communication.
Oui, en même temps je ne sais pas si le moment cathartique se situe dans les premiers jours ou dans les derniers. Lefebvre, par exemple, associe la fête au massacre: la fête finit dans le massacre parce que l’acteur va jusqu’au bout de lui-même donc jusqu’au sacrifice. En réalité, il est difficile d’exprimer quelle est la partie de Paris, passés les premiers jours d’enthousiasme, qui suit réellement la Commune. Il semble qu’à la fin du compte, les choses soient très vite rentrées dans l’ordre, dans le triste ordre, et que peu de gens soient allés jusqu’à risquer leur vie pour la Commune.
Je voulais vous poser assez vite ma dernière question. Vos propos m’y ont fait penser. Vous disiez qu’on peut faire de la politique directement, spontanément, et que lorsqu’on vit une expérience, qu’on se donne à une expérience, on apprend plus en quelques mois qu’en vingt ans d’école. Moi je vous entends quand vous dites ça, mais en même temps, j’ai envie d’ajouter quelque chose qui rejoint à la fois ce que vous avez dit sur la Commune et sur la vie quotidienne aujourd’hui: pour pouvoir inventer, pour pouvoir créer, sans doute que la spontanéité, l’élan, si je le retrouve en moi, sans doute que ça compte. Je ne veux pas paraître pessimiste mais si j’ai eu dix, quinze, vingt années où j’ai appris, où on m’a forcé à être passif, est-ce que même à travers ces élans, ces rencontres, ces mouvements qui sont étonnants et qui déchaînent de la créativité, je peux quand même inventer? Si depuis longtemps on m’a appris à subir, est-ce que vraiment je vais renaître et naître créatif en quelques instants?
Ce qui est étonnant, finalement, c’est à quel point les choses tiennent à un consentement général. Il n’est pas de moment dans l’Histoire où un simple non n’aurait pu tout changer. Quand on regarde n’importe quel moment, mettons le pouvoir d’un seigneur féodal, il ne tenait qu’au consentement: un individu unique ne peut rien contre une collectivité qui prendrait conscience de son aliénation et qui voudrait la supprimer. Donc l’étonnant n’est pas la révolution; ce qui m’étonne c’est qu’il n’y ait pas continuellement la révolution!