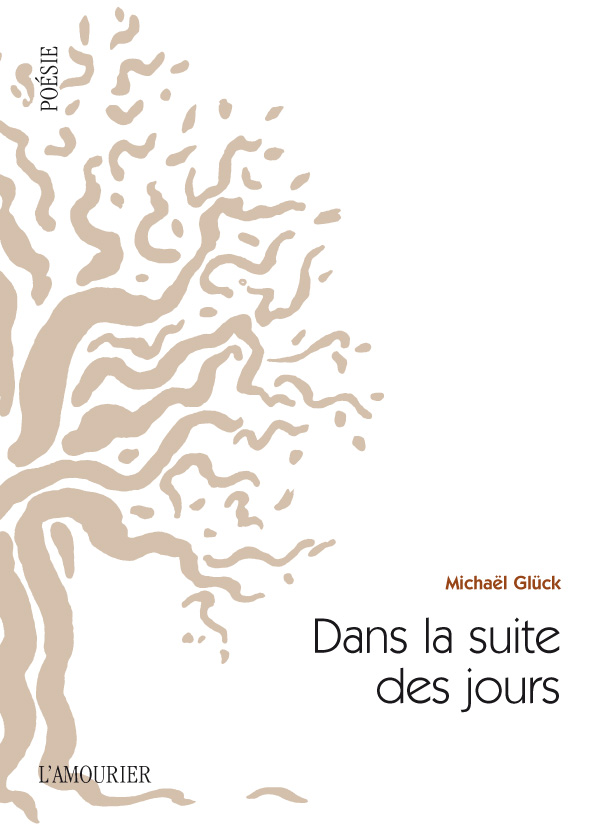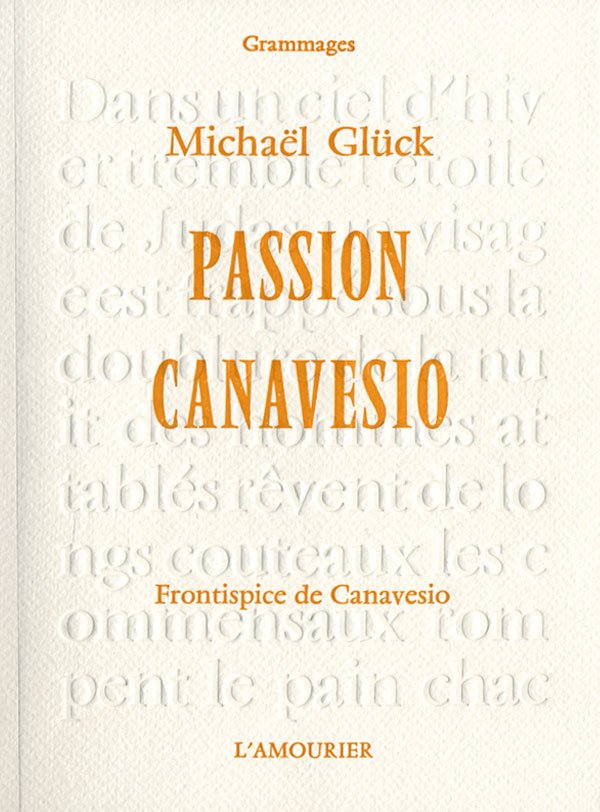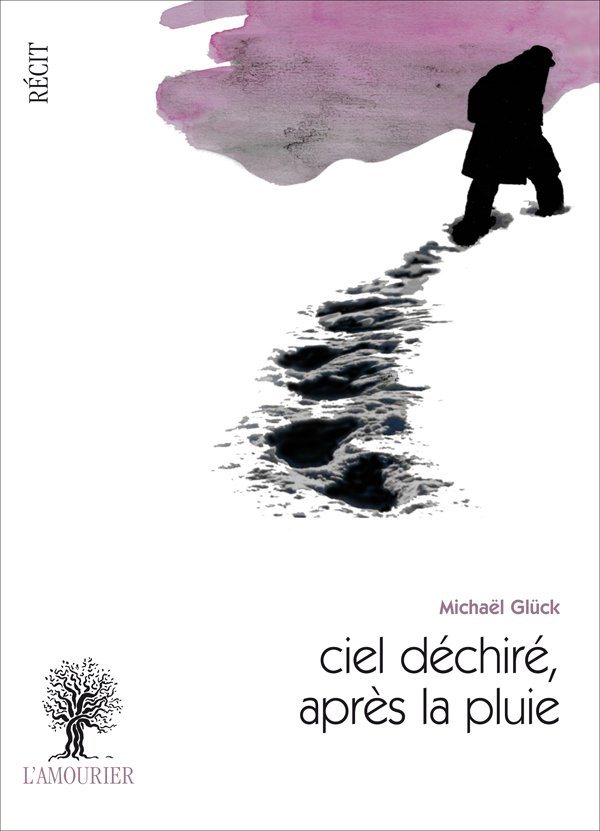Entretien avec Michaël Glück
Conduit par Alain Frexe pour la gazette Basilic
Il y a une nuit dans la nuit
Joë Bousquet
Ça y est ! La somme des 7 jours augmentée d’une nuit voit le jour aux éditions L’Amourier dans la collection Fonds Poésie. C’est un fort livre de quelque cinq cents pages.
J’aime qu’à cette reprise, Michaël Glück et son éditeur aient ajouté un plus, un “ pluz-une ” ! Et c’est le chaos qui resurgit. Non pas le désordre mais la fente première : l’inarticulé, l’irrévélé, l’irrésigné. La séparation fondatrice. Oui, “ Au commencement est la nuit / toujours la nuit ”, “ la nuit sans nom ”, Albe la blanche, si c’est là un des noms de ce qui serait espace lisse et blanc d’avant tout signe.
J’aime que Dans la suite des jours devienne dans la suite des nuits ! J’ai vu le jour dans la nuit écrit Michaël Glück dans son avant-dire intitulé Ouvrir la nuit. Oui, ce serait là le début de sa genèse ! N’est-ce pas toujours là que ça se passe ? Cette nuit d’avant toute nuit, nuit de l’intimité – là où il ne fait jamais assez noir, disait Joë Bousquet – son fonds, comme un non-lieu que tente de rejoindre l’écriture poétique, là où la conscience essaie d’entrer par effraction en risquant ses pauvres mots et tente de faire passer dans le jour la nuit demeurée nuit. Oui, “ il nous faut la trouer (la nuit) / de petits jours / les mots ”.
Alain Freixe :
Dans l’entretien que tu m’accordais, Michaël, dans le Basilic N°31 – on peut télécharger tous les numéros du Basilic à partir du site amourier.com – en décembre 2008, répondant à une de mes questions sur ce cycle Dans la suite des jours sur ce que j’appelais “ sept respirations décisives dans les marges de la bible, sur les bords du Livre ”, tu me disais que les questions que tu lisais dans La Genèse étaient “ une invitation à une autre écoute – à une désobéissance radicale ”, à quoi, à qui, à la langue dans la langue ?
Michaël Glück :
Pour commencer, parlons d’autre chose… Sans doute auras-tu reconnu, dans ce petit train de mots, le début de ce court et magnifique livre de Samuel Beckett : Le monde et le pantalon. Ces premiers mots ne sont pas tout à fait les premiers. Le texte commence par un court dialogue que je voudrais citer in extenso :
LE CLIENT : Dieu a fait le monde en six jours, et vous, vous n’êtes pas foutu de me faire un pantalon en six mois.
LE TAILLEUR : Mais, monsieur, regardez le monde, et regardez votre pantalon.
Il me plaît, dis-je, pour commencer de parler d’autre chose, de parler de couture, de travaux d’aiguilles. Comment comprendre l’écriture, texte, texture – autant que tessiture – sans dire d’abord l’ouvrage des petites mains. Lirait-on l’Odyssée, sans le travail de la navette, sans la trame du récit dans les fils de chaîne. Un drap est jeté sur la nuit. De fil en aiguille, nous apprenons à y ouvrir les jours. Ouvrir, s’ouvrir, oeuvrer. Offrir. Travail de Pénélope, de Shéhérazade. Mais Genèse ? diras-tu. La nuit avant le jour. Le féminin, la maison. La première lettre engendre le livre, la première lettre est maison, elle est deux. Beth. Au commencement il y a deux, deux jambes sur lesquelles s’appuyer, tenir, avancer. Parfois à l’aveugle, mains tendues vers la nuit. Ou par elle. Aimanté. C’est si simple. Quand j’écris ceci : J’ai vu le jour dans la nuit. C’est si simple, aussi simple qu’écrire : Je suis né une nuit de juin à 22 h 30. Mais ce ne sont pas ces mots-là qui sont venus. Je ne suis pas entré dans un récit, un roman autobiographique. J’ai vu le jour dans la nuit et je suis entré dans le poème. Pour écouter autrement. Être à l’écoute d’une autre langue. En finir avec la surdité, l’absurdité de l’obéissance. Pulsion d’obéissance, pulsion meurtrière. Le poème rompt avec cela.
Alain Freixe :
Reprendre les sept volumes du cycle Dans la suite des jours, y ajouter un huitième volume, Plus une nuit, très belle – belle d’être si juste à mes yeux – méditation sur cet entre-deux jours qu’est la nuit, toujours “ plus une / indéfinie ou secrète ”, cela ouvre sur une somme de quelque 500 pages. Quand on se retourne sur ces quinze années d’écriture, que l’on arpente ces pages, que l’on réinvestit ces mots, de quoi se retrouve-t-on lesté ? ou allégé ?
Michaël Glück :
Impressionnant. Quand j’ai vu, pour la première fois, ce volume sur la table de L’Amourier lors du récent salon de L’autre livre, une forte émotion. Un pavé, peut-être. Sous ce pavé, les pages. Le sablier des jours. Entre le berceau et la tombe. Quand on s’y retourne, demandes-tu ? Je ne sais si lesté ou allégé. Oui je suis augmenté de ce livre qui m’a donné des ailes, sans doute. Dans la suite des jours entre Ouvrir la nuit et Plus une nuit. Lesté, allégé ? Dans l’entre-deux. Le livre, la vie sont toujours un entre-deux. Beauté des lèvres qui se séparent pour la venue de la parole, beauté des lèvres de la fente première, pour reprendre tes mots. Le volume Le Lit dit, je crois et espère qu’on l’entend, cela d’une éthique inséparable d’une érotique.
Alain Freixe :
Le repos, septième et dernier livre de Dans la suite des jours n’est qu’un répit, un retrait, une halte… un peu comme une porte à pousser pour continuer – “En avant, route ! " disait Rimbaud – continuer à marcher dans l’inachevé et se poser à nouveau, un jour prochain, debout dans le sillon des lendemains… Y a-t-il un terme à cette errance, à ces chemins noircis ?
Michaël Glück :
Pourquoi faudrait-il une fin à l’errance ? Pourquoi y faudrait-il un terme ? Je préfère continuer à marcher dans l’inachevé. Quant à l’achevé… laisse-moi encore quelques années. Pour l’heure n’accueillons que les achevés d’imprimer. C’est bien l’absence de repos, qui fait l’achevé. C’est l’absence de repos, de soupir dans le chant ou dans la phrase, dans le métier de vivre, c’est bien cette absence qui est mortifère. Sept jours sur sept ? rien qu’un enchaînement machinique, productiviste, pornographique, celui-là même de l’édification des tours de Babel, celui-là même du rabattement des langues au profit d’une langue unique. Comment ne pas voir dans la tentative d’un espéranto, un désespéranto fondamental. Entre l’achevé et l’inachevé il y a des enjeux nécessairement politiques. Le poème est cet écart qui pointe la terreur à l’œuvre dans l’invention des “éléments de langage".
Alain Freixe :
“Inapte / à l’au-delà / inapte” écris-tu dans L’Échelle. Comment dès lors vouloir revisiter, à partir de cette inaptitude avouée, la Genèse, ce premier livre de la Torah ? Comment faire quand on se dit “lecteur et écrivain sans dieu” ? Comment faire avec son fond métaphysique ? Comment penser la sortie hors de l’unité, la manifestation ? Comment penser la séparation : acte d’expansion ou de retrait ?
Michaël Glück :
Comment penser la séparation ? quelle belle question ! Je me demande s’il ne faudrait pas, lors d’une prochaine réédition de ce volume lui donner pour titre Le livre des séparations, ou du moins l’apposer en sous-titre. D’autres nuances seraient possibles, d’autres mots : un livre des distances ou bien un livre des écarts. J’écris, je dis mon inaptitude à l’au-delà. Je ne l’avoue pas, cher Alain. Il n’y a que je sache aucune faute, aucun délit, sauf à entendre sous ce mot – dé-lit – quelque chose d’un dé-faire de la lettre, d’un lire autrement. Le poème n’est pas une faute, mais une vocalisation, c’est-à-dire une offrande, une liberté du chant, le poème est invention de la polysémie (ou retour à elle) contre le polythéisme mais aussi contre sa réduction à l’un seul. L’un-seul, j’assume le jeu des mots, est soumission à la mort. L’unité dont tu parles, la sortie est arrachement à la confusion, mise en mouvement du poème dans les jambes, dans le pas, dans la marche autant que dans la voix. Parole d’errants. Ces années d’écriture dans cette écriture des commencements m’ont appris à lire, sans fond, sans arrière-monde, sans au-delà. Je ne lis pas la Genèse comme un poème des profondeurs, mais comme un poème de la verticalité du face à face, sans racines ni au-delà.
Alain Freixe :
“Je m’obstine à écrire / dans les marges écrire” écris-tu, tant il est vrai qu’on désespère de l’écriture et que pourtant on continue à écrire comme s’il s’agissait à chaque fois de réitérer un “Non”, “dans la langue / contre la langue” et que ce “Non” soit de silence, un creusement, un évidemment dans le trop-plein de mots, d’images, d’informations, un “non” à tout ce qui nous asservit, nous aliène mais pour quel “oui”, Michaël ?
Michaël Glück :
Je bâtis ma demeure… Tu sais ce beau titre d’Edmond Jabès. Tout commence par des chansons : “Lundi, une aiguille / Attend le fil à coudre.” Je bâtis… Je suis toujours ému par le temps choisi, ému par ce présent qu’il faut entendre comme indicatif autant que comme offrande. Le présent est le temps du poème, il est son don. Le présent est ce oui d’avant le non. L’asservissement est la fabrique d’un autre oui, d’un simulacre de oui d’une soumission, ce oui de l’opinion. Je n’ai pas d’opinion. Je n’opine pas. L’opinion ne pense pas, écrit Gaston Bachelard. Je bâtis, je bâtis ma demeure, je m’obstine à écrire, dans la langue, contre la langue, oui. Cette obstination, cette réitération est autant un non qu’un oui. Non, il n’est pas écrit elle est née d’une côte de il. Non, il n’est pas écrit la multiplication des langues est un châtiment, ni Ismaël se moquait d’Isaac. Non il n’est pas écrit : égorge ton fils. Le non retourne au oui du texte, au oui de l’enfoui, de l’oblitéré. Le non est un oui de l’écart. Je m’écarte de toi pour te voir, pour te saluer, de visage à visage. Le non est recherche de la juste distance. Oui du poème non fusionnel.
Alain Freixe :
Le poème, cet “escalier des questions" pour reprendre un titre qu’avait confié aux éditions de l’Amourier Charles Dobzynski qu’il me plaît de saluer encore dans ces pages, le verrais-tu comme une “échelle" de corde, jetée sur les ravins noirs de notre monde, susceptible de faire passerelle entre les hommes ? Vers quelle autre rive, Michaël ?
Michaël Glück :
Escalier des questions. C’est bien de questions en questions que nous allons. Les réponses, LA vérité sont sans question. Portes possibles d’un enfer. Oui échelle, cette fragilité de la corde (comme celle d’un instrument de musique et tu sais mon amour des quatuors à cordes), jetée tendue au-dessus des gouffres, passerelle. D’une rive à une autre. Ces bâtisseurs de pont que j’évoque dans La table. Les traducteurs. Savoir cela, que l’autre est inexorablement incompréhensible, accueillir cela et pourtant avoir cette approche amoureuse, infiniment amoureuse d’un entre-deux de la traduction.
Alain Freixe :
Une dernière question plus générale, Michaël : comment ça commence pour toi, l’écriture ? Qu’est-ce qui te courbe et te pousse dans le dos pour que tu te mettes à écrire ? Une proposition, une impression, une sensation, une émotion plus ou moins violente au hasard des rencontres ?
Michaël Glück :
Comment ça commence, sans doute comme tout commencement, cela commence par une séparation, un arrachement, un non posé face au temps désœuvré. Cela commence par un livre refermé, poussé au bord de la table, par un cahier qui vient prendre sa place, par un cut, une coupure qui laisse venir cette montée du noir, de l’encre, entre deux battements de paupières, par un shunt, un détournement de la musique du dehors, une dérivation sonore qui se ressource au flux intérieur. Ce qui me courbe quitte la ligne droite, est curviligne dans le plan de la marche, ce qui me courbe m’oriente, me désoriente, ne m’incline pas vers le sol pour me soumettre mais est plutôt ligne d’erre. Je ne sais si me pousse ou m’attire, m’aimante, le visage, oui je peux dire cela, le visage. Me tenir debout pour aller vers le visage, me redresser, m’extirper, c’est à dire m’arracher aux racines. Laisser faire le rhizome plutôt que la racine. Au commencement est la nuit, le silence qu’il faut traduire.