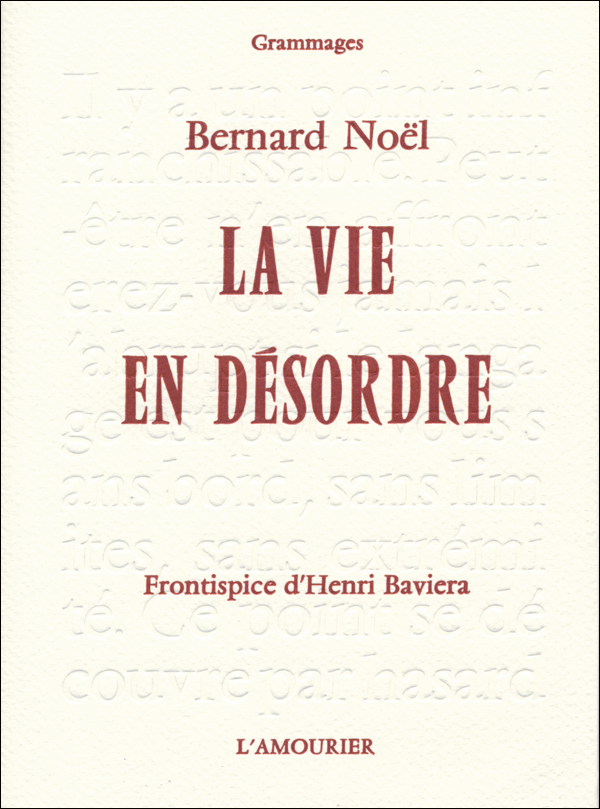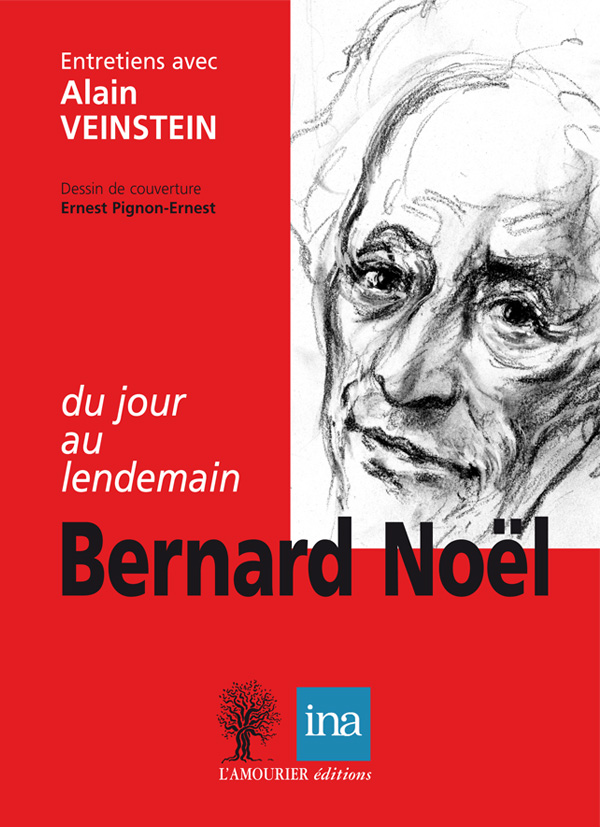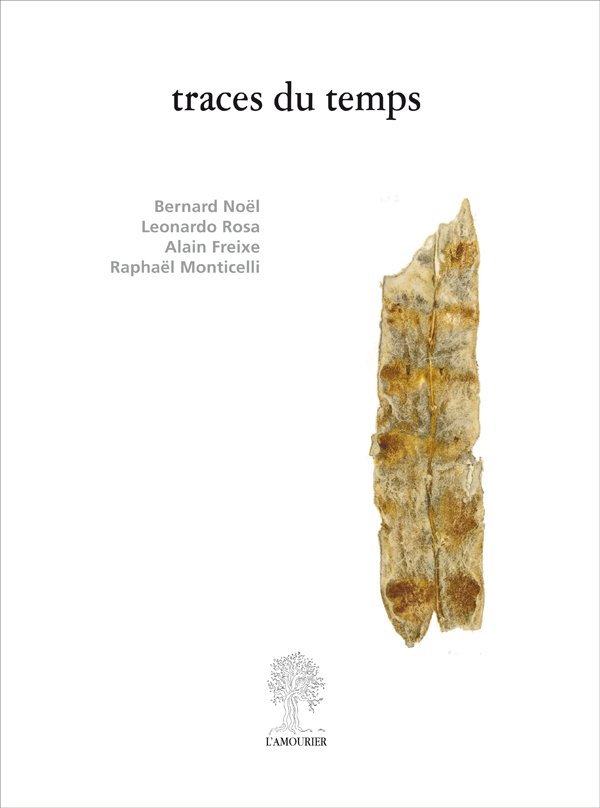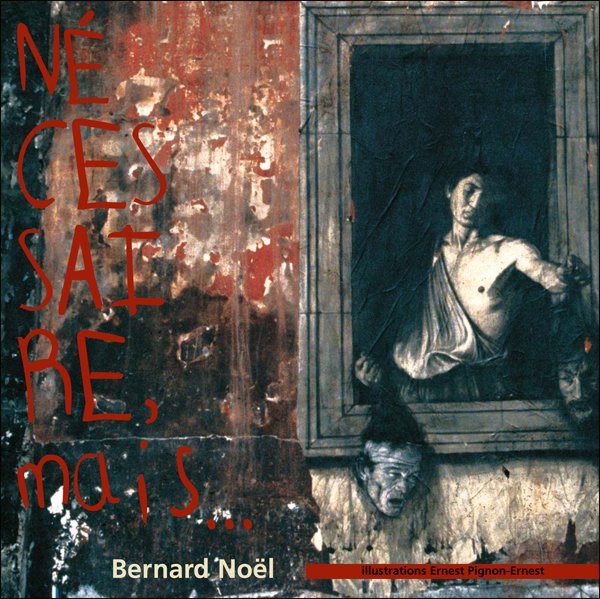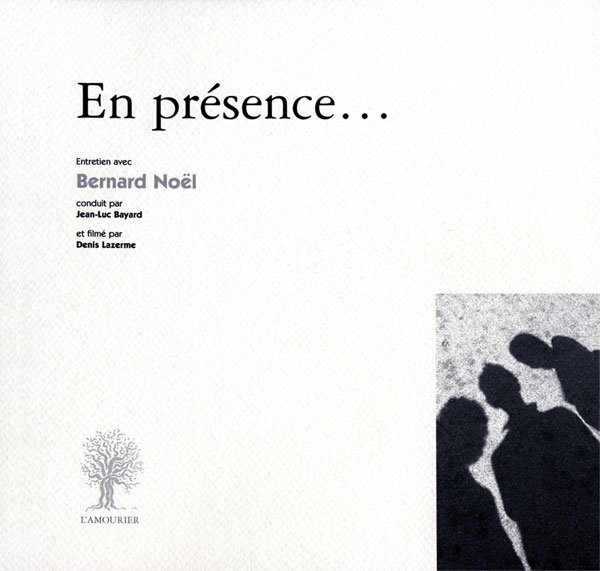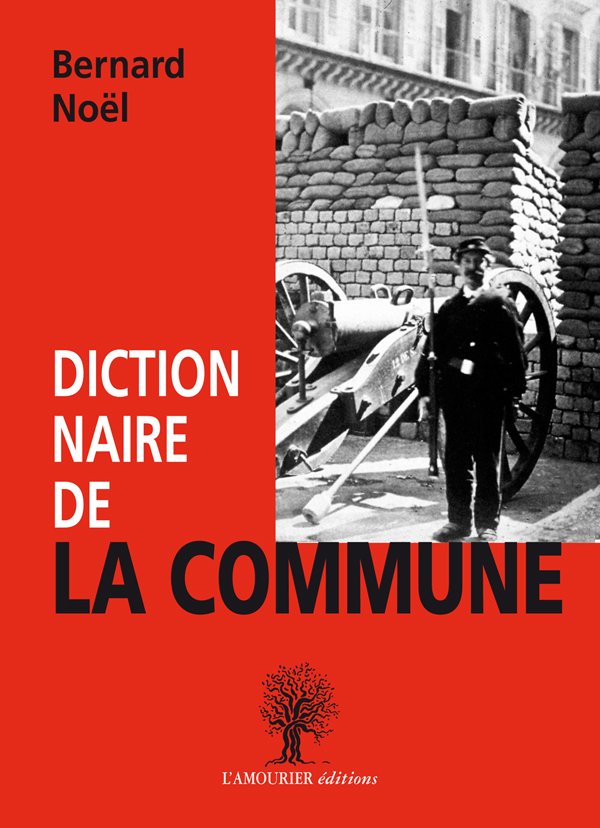Les ruines de l’Athos
Hommages d'auteurs et amis de l'Amourier
Les ruines de l’Athos
par Gérard CARTIER
Présence de Bernard Noël
Si j’en crois ma bibliothèque, j’ai lu assez assidûment Bernard Noël dans les années 70 de l’autre siècle, en particulier ces extraits du corps dont la singularité fut aussitôt saluée: une poésie qu’on pourrait dire matérialiste (pas de transcendance, pas d’effusion, aucun des moyens ordinaires du lyrisme), aussi peu réaliste pourtant que possible, entraînant le lecteur dans un univers étrange qui fait penser, par son caractère clos et organique, aux mondes personnels créés avant lui par Antonin Artaud ou Henri Michaux. Je crois me souvenir que ces aventures anatomiques m’avaient plus intrigué que convaincu. En dépit de leurs vertus irritantes sur l’esprit, comme sur la langue ces poivres dont on relève un mets trop fade (la poésie convenue qui continuait alors à prospérer), elles n’avaient pas à l’époque (peut-être faudrait-il que j’y revienne), emporté de ma part cette adhésion intérieure qui fait taire toute réserve.
Le Château de Cène, à quoi certains réduisent Bernard Noël, lu récemment par le hasard d’un exemplaire exhumé dans une librairie ancienne, m’a laissé lui aussi une impression mêlée. S’étant laissé prendre aux pages initiales, qui relèvent de la fable ou du rêve érotique, le lecteur se voit brusquement jeté, au fond d’un château labyrinthique, victime plutôt que spectateur, dans des scènes de cauchemar d’une brutalité profondément dérangeante (ce pour quoi elles sont faites), qui débouchent au réveil, non sur une fin utile –au récit, à la pensée, à la compréhension de l’homme ou de la société–, mais sur un théâtre cruel dans une sorte d’Utopie élitiste dont je n’ai pas su discerner l’intention. La dénonciation des atrocités des guerres coloniales, que Bernard Noël avait voulu métaphoriser, n’y est pas réellement sensible; il s’est d’ailleurs plaint que la critique y ait été moins attentive qu’au scandale moral que constitue ce personnage animalisé par le moyen du sexe.
On l’a compris, tout en reconnaissant l’originalité de l’œuvre, je ne fais pas partie des Noëliens ou Noëlistes inconditionnels: ceci dit par souci de vérité, et pour préparer ce qui vient. Car il y a d’autres Noël. Quoi de commun entre Le Château de Cène et, écrit immédiatement à sa suite, le Dictionnaire de la Commune, où (peut-être en réaction aux incompréhensions suscitées par sa fable) il affronte sans masque les terribles vicissitudes de l’Histoire? Autre encore est l’auteur des récits énigmatiques qui ponctuent son œuvre, jusqu’à cette Machine à voir parue il y a deux ans (sans doute écrite bien avant: la monnaie y est le Franc), où l’auteur imagine une vaste machinerie rendant sensible ce qui est l’une de ses obsessions spéculatives, les relations entre la vue, le langage et la pensée: sorte de machine de Morel transformant les pensées humaines en images, mue par le jeu des associations d’idées –au lieu que l’invention de Bioy Casares changeait les êtres en fantômes. L’éventail des thèmes et des manières de Bernard Noël est large, assez pour que chacun y trouve son bien.
J’en viens à ce qui est pour moi l’un des plus beaux livres de poèmes des dernières décennies, au même titre que, par exemple, La Descente de l’Escaut de Franck Venaille: Le Reste du voyage (P.O.L., 1997). Je l’ai lu il y a plus de 25 ans. Quand tant de livres s’effacent irrémédiablement aussitôt refermés, mon souvenir du «passant de l’Athos», l’ensemble de poèmes qui ouvre le recueil, est resté mystérieusement intact. C’est peut-être cela, un grand livre: sur lequel le temps semble n’avoir pas de prise. Le sujet en est pourtant modeste. Il s’agit de la chronique d’une retraite de l’auteur dans la république monastique du Mont-Athos, hôte d’un monastère pratiquement abandonné où seuls quelques moines continuent à prier et à célébrer les rites ancestraux au milieu de bâtiments qui retournent peu à peu à la poussière. De ce séjour dénué d’événements, Bernard Noël fait un grand poème composé de bribes ajointées à sec, généralement en courtes strophes, souvent moins d’une dizaine de vers, autant qu’il m’en souvienne (qu’on me pardonne ces hésitations: mes livres sont inaccessibles, encartonnés pour un an), qui donnent à voir, au sein d’un paysage sauvage, des cours à l’abandon, des murs fendus, des fenêtres bâillant à la pluie, des pièces jonchées de plâtras, des débris de statues, de meubles, d’objets rituels. Ce lieu dévasté est recréé dans une langue sobre, et parfois austère, néanmoins inventive, qui me touche merveilleusement, et dans un mètre unique, l’endécasyllabe, dont le boitement épouse ce récit de ruines. J’en retrouve sur mon site un extrait, relevé pour mon plaisir, qui donne une idée de cette langue magnifique, plus prenante encore quand on l’éprouve dans sa continuité:
…l’aigle et Jean même auréole et plus qu’une aile
au lion de Marc un petit lac de larmes
Luc le visage mangé par le moisi
est devenu un nègre à la barbe blanche
plus de Mathieu juste un trou dans le mortier
et quelques os de brique rose un frelon
tire mon regard vers là-haut la coupole
au premier cercle les restes d’une épaule
dans le second huit anges chacun six ailes
deux vers le bas deux vers le haut deux ouvertes
le tout d’une sensualité extrême
chaque ange paraissant par deux fois pourvu
de la zone bien fendue que les humaines
n’ont qu’une fois et l’amour serait à faire
dans un embrassement du haut et du bas
circulaire et sans fin une roue toujours
en mouvement…
Qui est attentif aux formes pourrait en tirer une manière de leçon. Après l’extraordinaire fortune de l’alexandrin, dont le rythme égal, harmonieux, aux nombreuses symétries, était l’outil parfait de ce qu’on a dit être le génie français; après lui, donc, si notre époque pouvait se plier à un mètre, le vers de 11, inégal, tronqué, bancal, pourrait être celui de notre esthétique…
On s’étonnera peut-être du désordre de ce témoignage : sans le secours d’aucun ouvrage, livré à ma seule mémoire, je dois m’en tenir aux débris que l’œuvre a laissés en moi –aux ruines de mes lectures, selon le mot d’Olivier Rolin, aux ruines de ce Mont-Athos qu’érige sa vie durant tout véritable écrivain, lesquelles, mieux que les analyses savantes, témoignent de l’importance d’une œuvre à nos yeux.